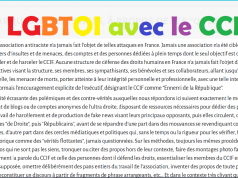[…] Alors même que des groupes se revendiquent queer par résistance à l’homonormativité des groupes LGBT, au sein de ces mêmes mouvements des critères libéraux persistent et nourrissent l’assimilationisme néolibéral : l’injonction à souscrire à une « façon d’être queer » par l’hypervisibilité sans questionner ses normes blanches sous-jacentes en est un. Dans une France postcoloniale peu encline à traiter les conséquences contemporaines de son histoire, et lorsque leurs deux identités sont mises dos à dos, les enquêté·es choisissent ouvertement de protéger leur communauté de race contre les discours homonationalistes et homonormatifs.
Par Najwa Ouguerram-Magot
Paru initialement dans GLAD!, 3 | 2017
https://www.revue-glad.org/759
On essaye de t’imposer des normes. C’est des personnes qui se battent contre l’hétéronormativité et l’hétérocentrisme qui veulent que toi tu te outes selon leur notion de outer alors que non, toi t’as peut-être d’autres notions. On n’a pas la même culture. Ok, on est Français et Française, parfois même pas, mais dans tous les cas nous on a une autre culture. Moi je suis désolée, mais ma culture africaine sera toujours plus présente que ma culture française.
Émilie, bisexuelle et afrodescendante, 21 ans
Dans de nombreux discours militants français, une croyance domine : se dire ouvertement non hétérosexuel·le, être reconnu·e comme tel·le, être out – ce serait s’assumer, s’émanciper de l’hétéropatriarcat. Ne pas l’afficher, être dans le placard, serait au contraire faire le jeu de la norme hétérosexuelle, faire, dans le silence, l’aveu honteux de son homophobie intériorisée. Pourtant, le coming out recouvre des usages et modalités qui diffèrent selon chacun·e. La possibilité, ou non, de faire un coming out, et donc la possibilité, ou non, de se présenter et de s’affirmer comme queer dépendent largement de l’âge, de la classe, du genre, de la race de chacun·e. Dans un contexte postcolonial, l’injonction à faire son coming out pèse par exemple différemment sur les personnes non blanches [1].
Mon projet de recherche naît d’un constat personnel : les milieux militants queer [2] franciliens m’apparaissent certes riches et dynamiques — mais particulièrement blancs [3]. Or, la sous-représentation [4] des queers non blanc·hes m’a semblé soulever une tension : pour qui le fait d’être perçu·e queer dans les milieux militants a-t-il un coût excessivement élevé ? Pour qui faire son coming out est-il envisageable ? Qui est représenté·e par son usage, et qui en est exclu·e ?
Pour contextualiser certains enjeux spécifiques aux queers non blanc·hes, l’« homonationalisme » est une notion intéressante à développer ici. Conceptualisée par la théoricienne queer non blanche Jasbir Puar [5], le terme est à l’origine un outil pour analyser les nouvelles politiques mises en place à l’égard des populations musulmanes en contexte occidental post-11 septembre. Dans son ouvrage, Puar explore par quelles opérations la « guerre contre le terrorisme » aux États-Unis en vient à revitaliser le patriotisme hétéro- ou homonormatif et participe au déplacement du stigmate national d’un groupe, les queers, vers un autre, les personnes supposées musulmanes. Elle reprend elle-même à Lisa Duggan son concept d’homonormativité, défini comme « une nouvelle politique sexuelle de type néolibéral » qui intègre les sujets non hétérosexuels dans « une politique qui ne conteste pas les institutions hétéronormatives dominantes mais qui les soutient et les fortifie [6] ». Posé simplement, l’homonationalisme reproduit des codes (économiques, éthiques) libéraux et invoque des arguments homofriendly au nom d’un « nous » libéral et progressiste occidental contre un « eux » barbare, homophobe et étranger. En mobilisant la figure de l’étranger renvoyé à une homophobie inhérente à « sa » culture, cette rhétorique justifie entre autres la production de discours racistes islamophobes. L’identité de cet étranger est d’ailleurs floue et regroupe grossièrement toute personne arabe et/ou noire possiblement associée à l’Islam. Par cette rhétorique, les discours homonationalistes tendent à dissocier « nos gays », supposés blancs, des autres figures non blanches, présumées hétérosexuelles. À l’échelle de la trajectoire non hétérosexuelle de personnes queer non blanches, la traduction est simple : pour être accepté·e dans les milieux queer, il faudrait faire preuve d’intégration en se désolidarisant de sa communauté raciale par un coming out clair.
Sur la question des enjeux que peuvent rencontrer des queers non blanc·hes en contexte occidental, peu de travaux sociologiques ont été menés. On peut relever les travaux de Carlos U. Decena sur des migrants gays dominicains à New York. Dans son ouvrage phare [7], Decena élabore la notion de « sujet tacite » comme sujet queer défiant le cadre binaire qui n’envisage que silence ou déclaration. C’est sur la base de ces travaux que Salima Amari aborde elle aussi la question du « tacite » dans son travail pionnier en France sur les « lesbiennes maghrébines [8] ». Dans ses travaux elle reprend l’expression de Decena et analyse le « contournement du coming out [9] » par ses enquêté·es au nom de ce qu’elle appelle une « loyauté filiale [10] ». En travaillant elle aussi sur cette façon alternative de dire sans déclarer explicitement, d’évoquer sans montrer frontalement, elle décrit par quelles stratégies le « coming out censé apporter une fierté d’être lesbienne n’est pas intégré dans le parcours lesbien des femmes interrogées ». J’ai moi aussi été interpellée par ce vide scientifique, et c’est dans la continuité des recherches d’Amari, dans une perspective à la fois queer et décoloniale, que j’inscris mon travail. Par cet article, il s’agit pour moi d’étudier les effets de la race et du racisme sur l’identification sexuelle de ces six queers non blanc·hes afin de pouvoir amorcer une critique des mouvements queer en France qui, censés refuser l’assimilationnisme, semblent finalement promouvoir une forme blanche de queerness.
Les enquêté·es
Cet article se base sur un corpus empirique composé d’entretiens biographiques réalisés en région parisienne entre les mois de janvier et avril 2017 avec six personnes s’identifiant comme queers non blanc·hes. Les histoires migratoires des enquêté·es [11] et les environnements familiaux dans lesquels iels ont été élevé·es sont très hétérogènes. Émilie [12], l’aînée de trois enfants, a été élevée en banlieue parisienne par son père sénégalais catholique et sa mère suisse-guadeloupéenne témoin de Jéhovah. Leïla a été élevée avec son frère et sa sœur dans une ville de province par ses parents libanais·es et musulman·es. Charlotte a grandi avec son frère et sa mère alsacienne profondément athée, loin de son père martiniquais, dans une commune de la région parisienne. Ana a vécu ses douze premières années entourée de sa famille libanaise chrétienne au Canada avant de migrer avec ses parents et son frère à Paris. Soraya, d’une famille de quatre, a été élevée par ses parents algérien·nes et musulman·es, en banlieue parisienne. Enfin, Inès, de père kabyle musulman et de mère bretonne athée, a été élevé·e avec sa sœur dans une commune de la couronne parisienne.
En ce qui concerne les contextes familiaux et les trajectoires scolaires, plusieurs points caractérisent la spécificité du groupe que j’ai interrogé. Bien qu’aucun·e ne soit issu·e d’un milieu ouvrier [13], les enquêté·es rapportent des situations familiales très hétérogènes. Si les parents de Leïla sont tou·tes les deux médecins spécialisé·es (bac+11), la mère de Charlotte, elle, est diététicienne (bac+2) et son père, cuisinier, a arrêté ses études au collège. Les parents de Soraya, la mère préparatrice de commande en pharmacie et le père anciennement chauffeur de taxi, se sont tou·tes deux arrêté·es au bac. Les trajectoires scolaires des enquêté·es sont elles aussi peu homogènes. Émilie et Soraya ont par exemple toutes deux été scolarisées en lycées de ZEP en banlieue parisienne tandis que Leïla et Ana disent avoir bénéficié en partie d’une scolarité sélective et privilégiée. Un point commun pourtant : j’ai rencontré tou·tes les enquêté·es dans un cadre universitaire. Cinq sur six sont aujourd’hui encore étudiant·es en sciences sociales à Paris, avec un niveau d’étude allant de bac+3 à bac+6, et seul·e Ana est sorti·e de l’université (auto-entrepreneur précaire et aux faibles ressources parentales) après avoir obtenu son master. S’il est difficile de savoir si la trajectoire professionnelle des enquêté·es, encore en études, corroborera l’hypothèse d’Olivier Schwartz relative aux « dominés aux études longues [14] », ceulles-ci constituent un groupe étudiant diplômé, en cours de politisation et en possession de capitaux académiques élevés. Alors même que la classe des enquêté·es est une variable de grande influence sur leur réalité matérielle d’existence en tant que queers, je laisse volontairement la question de la classe, par ailleurs intimement liée à celle de la race, à des projets de recherche plus spécifiquement tournés vers cette question. En effet, malgré leurs inégalités de classe, j’aimerais développer une perspective comparative démontrant la transversalité, même partielle, des enjeux de race à l’échelle des trajectoires de ces six enquêté·es.
Malgré cette hétérogénéité, leurs trajectoires présentent des similitudes. Non blanc·hes issu·es de l’immigration postcoloniale, tou·tes ont entre 20 et 27 ans et ont donc été élevé·es dans des contextes occidentaux postcoloniaux entre les années 1990 et 2000. Aucune n’est primo-migrant·e (d’un pays anciennement colonisé vers une ancienne métropole coloniale) et tou·tes s’inscrivent dans un contexte familial diasporique. Chacun·e de leurs parents non blanc·hes, à l’exception du père de Charlotte, est primo-migrant·e et a migré entre l’adolescence et l’âge adulte. Tou·tes ont été assigné·es fille à la naissance et ont été socialisé·es selon les stéréotypes de genre correspondants (notamment renvoyé·es à certaines figures de féminité noires et arabes). Enfin, qu’iels soient lesbiennes, bisexuel·les ou pansexuel·les, tou·tes se disent non hétérosexuel·les et queer. Pour les enquêté·es, se désigner queer recouvre aux moins deux dimensions. D’abord, il s’agit pour eulles de revendiquer la dimension transgressive de leur non-hétérosexualité, sans pour autant employer de termes strictement délimités. Par ailleurs, iels tiennent aussi à rappeler que le queer dépasse largement la simple question « du genre du choix d’objet [15] » et se présente bien plus comme une resignification profonde des normes de genre et de sexualité. Bien que dans cet article le choix du terme queer renvoie en grande partie à la non-hétérosexualité des enquêté·es, cette deuxième dimension est elle aussi présente. En effet, la plupart des enquêté·es ont une présentation de genre désobéissant aux codes de ce qui est considéré comme une féminité respectable, policée, introvertie — que ce soit Ana, aux cheveux rasés près du crâne, qu’iel a pu avoir tour à tour en crête bleue ou violette ces dernières années, ou encore Charlotte et Émilie, aux cheveux colorés et aux nombreux tatouages et piercings.
Pour rentrer en contact avec ces six enquêté·es, j’ai directement contacté plusieurs personnes concernées par mon projet par le biais de groupes (queer ou antiracistes) auprès desquels je milite. Les enquêté·es proviennent donc en majorité de mon entourage relativement proche ; certain·es étudient, travaillent ou militent ensemble, tou·tes se sont au moins déjà croisé·es. En bref, les enquêté·es sont tou·tes des queers non blanc·hes, constitué·es en groupe plus ou moins fluide d’interconnaissances, politisé·es sur les questions de sexualité et de postcolonialité, socialisé·es à être des « filles issues de l’immigration postcoloniale [16] » et partagent des vécus révélant beaucoup sur certaines spécificités de la diaspora postcoloniale queer en France. C’est sur cette base commune que je chercherai à développer mon analyse.
Comment comprendre la sous-représentation des queers non blanc·hes dans les espaces militants queer sous le prisme des vécus non hétérosexuels de ces six enquêté·es ? Pour réfléchir à cette problématique, la question du passing m’a semblé être un point d’entrée particulièrement intéressant. Au sens large, j’entendrai par passing le phénomène d’être reconnu·e comme membre d’un groupe dominant alors même que cette identification ne correspond pas à son auto-identification. Une personne non hétérosexuelle peut par exemple passer pour hétérosexuelle. Pour réfléchir à l’intersection des catégories de race et de sexualité, je propose d’en investir les marges et les entrecroisements, en m’arrêtant sur la question du passing hétérosexuel chez des queers non blanc·hes. Je considérerai ici le passing par rapport à son corollaire le coming out. Si le passing équivaut à « ne pas être perçu·e comme non hétérosexuel·le », le coming out correspond au contraire à la formulation volontaire de sa non-hétérosexualité. Ainsi, j’inscris ma lecture dans ce que Eve Kosofsky Sedgwick a appelé l’« épistémologie du placard », mode de compréhension « moderne » de la sexualité dominant depuis le xixe siècle et dans lequel la distinction entre homo- et hétérosexualité occupe une place centrale. C’est, selon elle, à partir de ce tournant que l’« orientation sexuelle » est devenue une des « principales conceptions de l’identité individuelle [17] ». En faisant du coming out la colonne vertébrale de cette épistémologie sexuelle occidentale, le coming out est consacré comme « rite » de passage obligatoire dans un modèle binaire du visible / invisible.
Qu’est-ce que les expériences spécifiques de passing que font ces personnes racisées révèlent des présupposés raciaux qui entourent la non-hétérosexualité ? Pour être reconnues comme non-hétérosexuelles, quel type de déclaration est spécifiquement attendu d’elles ? Quels enjeux à passer rencontrent-elles spécifiquement ? Peut-on mettre en évidence des expériences de vécus non hétérosexuels spécifiques à des non blanc·hes ? À partir des premiers résultats de mes recherches, mon développement s’organise en trois temps. Dans un premier temps, j’ai choisi de réfléchir à la dimension pratique de ce qu’être queer non blanc·he implique pour les enquêté·es, sous l’angle du passing. Comment, en tant que personnes non blanches, les enquêté·es se débrouillent-iels pour vivre leur non-hétérosexualité ? Quels enjeux représentent pour eulles le fait de passer pour hétérosexuel·les ? À partir de cette première dimension, j’aborderai dans une deuxième partie ce que l’expérience d’une pratique dissidente de la non-hétérosexualité semble révéler : un régime de visibilité [18] tacite, qui défie le régime blanc, libéral et séculier [19] dominant. Enfin, en m’arrêtant non plus sur le propos des enquêté·es, mais sur le registre même de leur discours, j’ouvrirai mon analyse à une troisième spécificité : le fréquent recours à un registre de théorie politique qui accompagne une conscience de soi particulièrement politisée.
Entre race et sexualité, un conflit d’allégeance ?
Aucun·e des enquêté·es n’est out dans toutes les sphères de sa vie ni constamment perçu·e comme hétérosexuel·le. Ainsi, je leur ai demandé de décrire des situations dans lesquelles iels ont intentionnellement cherché à passer pour hétérosexuel·les. En réponse à cette question, chacun·e a décrit un processus décisionnel basé sur un calcul coût-bénéfice dans lequel iels évaluent comment adapter leur identité non hétérosexuelle [20]. Trois facteurs semblent particulièrement influencer ce calcul : les risques encourus dans l’interaction (physiques : être harcelé·e, agressé·e…, et professionnels : être discrétié·e, licencié·e…), l’énergie de l’enquêté·e au moment de l’interaction et, peut-être le plus significatif, la nature de la relation avec les personnes interagissant. Lorsque les enquêté·es décrivent les deux premières raisons (sécurité et énergie), iels ne se posent pas en rupture raciale avec les queers blanc·hes de leur entourage : blanc·hes ou non, beaucoup de queers se font passer pour hétérosexuel·les pour ces mêmes raisons.
Cependant, lorsque le troisième facteur est mentionné — celui de la nature de la relation avec l’interlocuteur·ice en jeu —, les enquêté·es se posent unanimement en rupture avec leurs homologues blanc·hes. En effet, tou·tes ont affirmé qu’à la différence des queers blanc·hes qu’iels fréquentent, iels inscrivent consciemment leur calcul coût-bénéfice dans une mise en balance entre identité de race et identité de sexualité. C’est par exemple aussi le cas pour Ana qui rapporte avec un mélange d’humour et de pragmatisme comme iel a pu vivre sa « non-hétérosexualité comme preuve d’occidentalisation » :
La manière que j’ai eu de vivre ma sexualité, et les codes blancs auxquels elle renvoyait, elle s’est faite au prix de mon inscription raciale. On m’a tellement refusé [mon arabité] au collège, au lycée, jusqu’à y a pas si longtemps, je me sentais dans l’imposture de tout. Je savais que j’étais pas arabe, que j’étais pas hétérosexuel·le, je savais que j’étais pas une meuf, même si c’était pas tout à fait au stade de me dire un mec. Et dans mon histoire, plus j’ai pu avoir l’air queer, moins j’avais l’air arabe. Entre mes 15 ans et 20 ans, la grosse partie de mon adolescence que je n’ai pas passée à me faire taper dessus dans des vestiaires de la cour, donc la partie dans laquelle je choisissais d’être qui je voulais être, les codes féminins que je performais étaient des codes volontairement ultra féminin-queer qui compensaient mon absence de légitimité à me sentir arabe. Je n’avais pas l’air arabe.
Pour Ana, non seulement ces deux identités s’excluent terme à terme, mais elles s’influencent : plus iel est perçu·e comme arabe, moins iel est perçu·e comme queer, et réciproquement. Inès fait le même constat d’avoir eu à mettre en balance ses différentes identités :
J’ai vraiment cette impression qu’on peut pas te lire les deux et ça devient souvent la situation où est-ce que tu choisis d’être l’un ou l’autre, au risque de trahir ce que t’es, parce que t’es les deux. Et c’est surtout l’idée de ne jamais être au bon endroit. T’as jamais un endroit en particulier et un sentiment d’appartenance en particulier parce que les gens te lisent pas. Donc t’es pas audible non plus. Une impression de pas savoir où mettre les pieds.
Comment expliquer ce sentiment d’inconciliabilité entre queerness et identité non blanche que tou·tes les enquêté·es disent avoir déjà ressenti ? Bien que la question ne soit pas au cœur de cet article, j’évoquerai brièvement un élément selon moi explicatif : la représentation du queer ou « l’idée normative qu’une personne queer est une personne blanche [21] ». En effet, au cœur de l’idée de représentation, on retrouve celle des réalités validées lorsqu’on en a des représentations disponibles, ou au contraire invisibilisées lorsqu’elles sont absentes. Ainsi, la blanchité des représentations queer [22], que ce soit dans des productions culturelles mainstream (films, séries, publicités, etc.) ou militantes (LGBT comme queer), promeut une compréhension de la queerness comme automatiquement blanche. D’une part, le privilège blanc d’être représenté·e invisibilise le racisme qui traverse les mouvements queer. D’autre part, ces représentations participent à la construction d’espaces, de pratiques et de discours queer qui, non seulement relèguent les queers (par défaut blanc·hes) et les racisé·es (par défaut non queer) à des espaces mutuellement exclusifs, mais conditionnent les queers non blanc·hes à cette dichotomie. Lorsqu’une personne non blanche est identifiée comme telle, a-t-on seulement les cadres cognitifs pour l’imaginer non hétérosexuelle ? Pour la première partenaire d’Émilie, il était simplement inconcevable qu’Émilie soit à la fois noire et lesbienne :
En fait on a tout le temps postulé de mon hétérosexualité du fait de ma non-blanchité. Je me rappelle que l’une de mes premières copines, on s’était rencontrée dans un skate park. C’était une amie d’amie, elle vient me voir en me disant qu’elle m’imaginait pas comme ça : « Je croyais que t’étais lesbienne ! ». Et je sais que c’est parce qu’elle savait pas que j’étais noire.
Le témoignage d’Émilie illustre une expérience que font tou·tes les enquêté·es de régulièrement se voir opposer les différentes facettes de leur identité. Si Ana, Inès, Émilie et tou·tes les autres enquêté·es ont dans un premier temps vécu ce conflit d’allégeance, c’est aussi parce que peu de représentations queer et non blanches invitent à imaginer les choses autrement. Face à cette difficulté à balancer entre race et sexualité, quelle position adoptent-iels ?
Leïla : Je pense qu’il y a des moments où j’ai pensé l’un [l’orientation sexuelle] sans l’autre [l’identité raciale], et généralement c’était des moments où j’arrivais pas à assumer l’un ou l’autre. Et c’est dans les deux sens. Y a des moments où je pensais que ça allait passer, que je vais rentrer dans le rang. Parce que c’est ta race, c’est ta culture, c’est ancré en toi.
L’enquêtrice : Est-ce qu’il y en a un qui prime sur l’autre ?
Leïla : Un peu plus ma race je crois. Parce que ma race c’est la partie la plus entière de moi. C’est aussi celle qui subit le plus d’attaques en ce moment, donc c’est celle que j’ai le plus besoin de défendre. […] Si j’en arrivais à perdre cet espace racial, ça m’en coûterait trop pour les raisons qu’on connaît : ça serait perdre une partie de toi. Je pourrais toujours me rendre au Liban mais ça serait jamais pareil. J’ai aucun équivalent pareil ici. J’ai été élevée dans un milieu que de Blancs à la campagne, privilégiée par ma classe. J’ai pas de repères en France pour cette dimension raciale. Perdre cet espace racial, ça me coûterait trop.
En clair, pour Leïla, être ouvertement non hétérosexuelle auprès de sa famille, ce serait non seulement prendre le risque de les perdre, ce qui a déjà un coût émotionnel lourd comme pour beaucoup de queers, blanc·hes comme non blanc·hes, mais c’est surtout prendre celui de se couper d’un « espace racial » rare. Dans des contextes diasporiques isolés, sa communauté de race constitue pour elle un refuge au racisme quotidien qu’elle ne semble trouver nulle part ailleurs en France, et donc trop précieux pour s’en couper.
Comme Leïla, tou·tes les enquêté·es ont recontextualisé leur identité queer dans un cadre de compréhension racial structurel et historiquement situé. Et c’est à ce niveau que se situe le sentiment de rupture avec leurs homologues blanc·hes. En effet, l’importance du travail de mise en balance entre « être l’un ou l’autre » chez les enquêté·es s’explique notamment par leur contexte familial diasporique, marqué par la migration des parents non blanc·hes entre ancienne colonie et ancienne métropole. À l’échelle de leur famille, la migration d’un membre entraîne une rupture mémorielle [23] qui a marqué certes les migrant·es, mais aussi leurs enfants né·es dans le pays d’arrivée. Dans ce contexte de diaspora, les enquêté·es s’inscrivent dans un ensemble d’enjeux liant parenté et mémoire : quel que soit leur lieu de naissance, « “parler famille” signifie “parler migration” [24] ». Migration et diaspora deviennent des marques constantes de l’identité sociale des enfants : que ce soit leur identité revendiquée ou leur identité assignée, les enquêté·es sont toujours renvoyé·es au statut étranger de « jeunes issu·es de l’immigration ». Mais, plutôt que de subir ce statut, iels préfèrent en valoriser ses composantes (langues, littératures, histoires nationales, etc.). Par exemple, tou·tes les enquêté·es sont dans une dynamique de « réappropriation » de leur histoire familiale qui passe tant par des voyages en autonomie pour s’« approprier » le pays de leurs parents que par un sentiment protecteur envers leur famille. En outre, si dans leur récit tou·tes les enquêté·es ont pour point commun la sensation d’avoir à mettre en balance leur double identité, c’est notamment parce qu’iels s’inscrivent dans ce contexte particulier : celui d’une France postcoloniale où les populations non blanches issues de l’immigration, renvoyées à une forme d’altérité, sont isolées. Or, en tant que fruits directs de la colonisation, les enquêté·es ont conscience que, dans ce contexte, une communauté fondée sur des expériences communes de racisme constitue une ressource précieuse pour s’en protéger [25].
Finalement, parce qu’iels évoluent dans un contexte postcolonial dans lequel circulent des rhétoriques homonationalistes, ces six enquêté·es révèlent une première spécificité non blanche de leur vécus non hétérosexuels : l’expérimentation régulière d’un conflit d’allégeance entre identité queer et identité non blanche. Aujourd’hui, lorsque les enquêté·es vivent leurs identités comme mises dos à dos, que ce soit par leurs sphères antiracistes majoritairement hétérosexuelles, ou leurs sphère queers majoritairement blanches, iels choisissent prioritairement de protéger leur communauté de race. Il ne s’agit pas ici ni de réduire les familles des enquêté·es à des espaces nécessairement queerphobes, ni de les décrire comme exemptes des dynamiques de genre et de sexualité. Les enquêté·es en ont conscience : comme la majorité des espaces sociaux, leurs familles sont traversées par un hétérosexisme structurel. Dans un même temps, les enquêté·es, certes queer, mais aussi racisé·es, ont aussi conscience que leur communauté de race constitue un mode relationnel crucial pour leur survie raciale. Accepter l’injonction homonationaliste à se couper de leurs communautés non blanches, c’est pour eulles prendre le risque de s’isoler dans un système d’oppression raciste.
L’intimité, le sexuel, l’affectif : un régime de visibilité dissident ?
Durant les entretiens, aucun.e enquêté.e n’a opposé les moments où iel passe volontairement aux moments où iel passe malgré ellui. Au contraire, du fait de leurs capitaux politiques, les enquêté·es ont pris conscience que leur assignation raciale s’accompagne de la possibilité de passer par défaut pour hétérosexuel·les et en profitent volontairement pour passer en temps voulu. Si la question même du passing, sa faisabilité et son coût, est indépendante de la volonté des enquêté·es, la réponse apportée, elle, est pleinement assumée. Émilie le formule explicitement :
Je vis beaucoup de misogynoire, d’exotisation de mon corps. On touche mes cheveux dans le métro, les collègues qui me disent que les femmes noires sont « comme ci, comme ça », « oh t’as des grosses fesses, oh t’as mis une robe qui te met bien ». Et je sais que là-dedans, y en a qui aimeraient encore plus le délire « lesbiennes exotiques ». C’est mort que je leur donne ça. […] En fait parfois le passing, c’est juste un moyen de résistance, t’as pas le choix. Moi mes collègues je me verrais pas leur dire. Si c’est pour me prendre de l’exotisation de mon corps et en plus des insultes homophobes, non merci.
En performant plus ou moins une identité qu’elle sait la protéger de la stigmatisation, Émilie se protège non seulement de l’homophobie qu’elle subirait, mais aussi des fantasmes racistes qui entoureraient sa non-hétérosexualité. Que ce soit par l’apparence [26] (habits dits féminins, cheveux longs), par l’attitude et la façon d’occuper l’espace (discrétion, timidité) ou par le discours (le contrôle constant de ses propos, le choix d’éviter les sujets jugés risqués), le passing chez les enquêté·es est une stratégie à mobiliser par protection contre un ordre hétérosexuel ; un moyen d’obtenir des bénéfices auxquels iels n’auraient sinon pas pu prétendre. Si cette hypothèse s’applique lorsque les enquêté·es évoluent dans les sphères qu’ils identifient comme blanches, qu’en est-il dans leurs sphères non blanches ? J’ai par exemple demandé à Leïla de me décrire comment elle concilie sa vie avec sa partenaire et sa vie familiale :
Leïla : Au niveau familial, j’ai mon oncle qui est sur Paris et chez qui j’ai vécu pendant un an. C’est à peu près à ce moment-là que j’ai rencontré une fille. Cette personne venait de plus en plus souvent chez mon oncle et ma tante alors que pendant un an jamais personne n’avait mis les pieds chez moi. La situation devenait je crois un peu trop claire. À partir de ce moment-là, j’ai commencé de plus en plus à performer une hétéronormativité pour me protéger.
L’enquêtrice : Comment t’as fait ?
Leïla : Déjà, je prononçais de moins en moins le prénom de ma copine, j’avais tendance à être un peu moins queer dans mon aspect : déjà j’ai les cheveux longs, après je venais habillée super chic, avec des petites chaussures cirées, une petite chemise proprette, et hop, ça passait.
L’enquêtrice : Et ça a marché ?
Leïla : De toute manière j’ai déménagé donc les indices ont un peu cessé. Mais je sentais qu’il y avait de la part de ma tante par exemple un soupçon sur ce qui se trame. Mais en même temps je pensais pas non plus risquer grand-chose. Comme si ma tante me disait « Je sens qu’il se trame quelque chose, je crois comprendre, mais ça me dérange pas trop donc je fais comme si de rien n’était. » Y avait un peu un flou presque bienveillant.
Dans cet extrait, il me semble intéressant de relever au moins deux dimensions. Dans un premier temps, Leïla a d’abord choisi de moduler sa façon de s’habiller selon l’impression qu’elle veut produire avec sa famille. Aussi, elle illustre de nouveau que le passing est pour les enquêté·es un moyen de se jouer au quotidien de différents codes hétéronormés. Cependant, elle ouvre dans un second temps une autre dimension. D’après elle, ce n’est pas tant l’efficacité de son passing qui l’a protégée que le fait que, sans explicitement le dire ni le montrer, sa tante ferait de toute manière « comme si de rien n’était ».
Dans quelle mesure une spécificité non blanche du vécu des enquêté·es réside justement dans le fait que ce souci de passer ou non n’en était pas toujours un ? En effet, si passing et coming out traduisent certes des réalités dans le vécu des enquêté·es, la question de passer ou non se pose surtout lorsque les enjeux de sexualité sont frontalement abordés, lorsque la vie privée est ouvertement discutée en famille ou en groupe. Si la question semble parfois importante pour les enquêté·es, elle semble l’avoir été principalement auprès de leur entourage blanc. Au contraire, auprès de leur communauté de race, elle apparaît de moindre enjeu — c’est du moins ce qu’a expérimenté Leïla chez son oncle et sa tante. Mon hypothèse est alors la suivante : contrairement au modèle le plus largement diffusé d’une sexualité ouvertement abordée dans les espaces queer, les enquêté·es s’inscrivent dans un régime bien plus tacite quand il s’agit de leur sexualité et, de fait, de leur non-hétérosexualité. C’est à cet égard que mon travail rejoint ceux de Decena et Amari, développant tou·tes deux l’idée du tacite comme alternative au déclaratif et au silencieux. Amari met par exemple en évidence dans son travail que si, « dans les mouvements gays et lesbiens, le coming out est passé d’un besoin de visibilité publique pour imposer une existence dans une société hétérosexuelle dominante à un besoin d’aveu et de reconnaissance à l’intérieur de l’institution familiale », les lesbiennes maghrébines qu’elle a suivies nouent au contraire un « accord tacite » au sein de leurs « familles qui choisissent d’ignorer les signes qui [les] empêcheraient d’exister [27] ». Selon moi, c’est dans cette même démarche que Soraya rapporte avec fierté refuser de s’inscrire dans ce régime de visibilité et de déclaration auprès de sa famille :
Les Blancs me demandent tout le temps : « Mais ta famille, ils sont au courant ? ». C’est difficile de répondre par oui ou non, tu peux pas parler de coming out à proprement parler dans sa vision blanche. Tu sens que nous déjà on a une structure familiale qui est totalement différente donc la communication est basiquement différente. Donc le fait de dire les choses, même s’il y a par ailleurs des tabous et des non-dits, ça passe pas forcément par un truc solennel de « Faut que je te dise maman ». Tu vois je dis « nous », c’est que pour moi y a une vraie scission, réelle.
Ce rapport à l’(homo)sexualité que décrit Soraya est partagé par l’ensemble des enquêté·es et, bien qu’il ne soit pas vécu comme la preuve d’un rapport frustré à leur sexualité, il est systématiquement renvoyé par leur entourage queer blanc à la manifestation d’un dysfonctionnement. Au contraire, à leur échelle individuelle, le fait d’évoluer dans des sphères où la norme n’est de toute manière ni dans l’énonciation ni dans la démonstration crée des situations où, de fait, la problématique se pose rarement sous la forme de conflits ouverts. Par exemple, lorsque Inès évoque les discussions sur la sexualité qu’iel a pu avoir avec ses ami·es militant·es queer blanc·hes, c’est avec rage qu’iel rapporte la colère alors ressentie à se voir ouvertement questionné·e :
Arrêtez de me parler de cul H24, ça me dérange pas que vous parliez du vôtre, mais ne me parlez pas du mien ! C’est super souvent sous-entendu que ça serait lié au fait que je sois racisé·e, ou que j’ai été élevé·e dans une famille arabe et musulmane. « C’est vrai que vous êtes pas beaucoup dans la démonstration d’affection vous ». On a pas les mêmes façons de tomber amoureux, d’être en couple, de nommer le mot couple, c’est pas du tout les mêmes perspectives.
Au sentiment d’être réduit·es à un « vous » exotisant, présenté comme incompatible avec les conventions de « démonstration d’affection », certain·es enquêté·es répondent au contraire par le rejet de ce qu’iels vivent comme une intrusion dans leur rapport à leur intimité. Soraya y voit la claire marque d’une rupture entre deux « façons » d’être queer — une blanche, légitime, et une autre, non blanche, inaudible :
On a d’autres codes, d’autres façons de parler qui sont moins vues par les Blancs parce que pas légitimes. Mais y a de l’amour entre nous, d’autres façons de se le témoigner. Mais ce truc de parler de soi… Déjà j’ai pas besoin de parler de moi, je me dis al-Hamdullilah [Dieu soit loué] j’ai été élevée dans ça, j’ai pas besoin de parler continuellement de mes émotions. […] On a pas du tout les mêmes vécus, ou même de ce qui est perçu comme violent. Leur violence et nos violences à nous… Tu peux pas t’ouvrir. C’est une question de réceptivité aussi. Qu’est-ce que tu veux aller dire un discours qui serait déjà d’office perçu comme… Alors qu’avec quelqu’un avec qui ça peut être productif, on se comprend, ça va vite.
C’est à cet égard que les enquêté·es se posent pour la plupart en rupture avec ce que Leïla a appelé la « culture blanche du ressenti blanc », une rupture qui se traduit par des régimes particuliers de déclaration, mais aussi de démonstration. En effet, ce constat ne s’applique pas seulement au rapport qu’entretiennent les enquêté·es à leur intimité physique, mais aussi à ce qui relèverait plus généralement de l’affectif dans son extériorisation quotidienne. Dans leur majorité, les enquêté·es ont spontanément relevé l’importance de leur modèle parental dans leur rapport à cette extériorisation. Tou·tes disent en reproduire, en partie, les « codes ». Par exemple, aux marques d’affection démonstratives jugées comme relevant de « codes blancs » (baiser, enlacement en public) sont préférées d’autres formes (le respect, l’écoute, la loyauté). Alors même que leur mode de relation non hétérosexuelle pourrait sembler être en rupture avec celui de leurs parents, les enquêté·es manifestent pour la plupart la volonté de s’inscrire dans leur continuité. Qu’iels soient non hétérosexuel·les ou pas, la question est moins celle de leur sexualité que celle de la manière de l’extérioriser.
Par cette « contre-visibilité » au sein de leur communauté de race, les enquêté·es ne font pourtant pas une expérience de queerphobie forcément plus violente que dans les espaces où, à l’inverse, les questions de sexualité sont plus facilement abordées. Émilie, par exemple, rapporte à quel point elle peut être épuisée de « [c]es milieux blancs qui [l]’enferment dans un cadre », réduisant tout au coming out :
Beaucoup de gens ont du mal à la comprendre, notamment les Blancs et les Blanc·hes. Ils ont trop l’habitude d’un extrême ou l’autre : soit ta famille t’adresse plus la parole, soit c’est hyper bien passé. Ils ont pas cet entre-deux culturel. […] J’ai l’impression que les Blancs sont tellement habitués à ce que le monde soit fait pour eux et qu’ils peuvent se balader partout et faire tout ce qu’ils veulent. Alors que non, moi je suis fille d’une personne immigrée qui est venue en France et ça toujours été : « Rase les murs et te fais pas remarquer ». Que ce soit la police ou ma sexualité, ça a toujours été : « Ne t’exhibe pas ». Bref, être visible, me montrer partout, c’est pas mon truc. Je me vois pas à la télé devant les caméras de TF1 à danser sur un char. Après je critique pas ceux qui le font, c’est bien de faire les choses en accord avec soi-même, mais l’impose pas aux autres.
La réflexion qu’Émilie mène sur sa propre visibilité est particulièrement intéressante en ce qu’elle dépasse largement le simple cadre de sa liberté sexuelle. Selon Émilie, le refus d’être hypervisible dans la rue et préférer des démonstrations plus réservées s’est traduit dans son rapport à sa race bien avant d’avoir un impact sur sa sexualité. Avant même que la question de se montrer ou non ouvertement en tant que bisexuelle se pose, celle des risques encourus à s’« exhiber » en tant que noire de quartier populaire, et donc cible privilégiée des violences policières, s’est imposée. En fin de compte, lorsqu’il s’agit de leur visibilité sexuelle, ce ne serait pas tant auprès des sphères queer côtoyées que les enquêté·es se sentent le plus en sécurité qu’auprès de leurs sphères racisées, parce que construites sur la même culture de l’intimité. Tou·tes les enquêté·es font part d’un violent sentiment d’inadéquation avec l’homonormativité de certaines sphères queer où leur culture de l’intimité n’est pas audible, voire n’est pas respectée. C’est à mon sens un nouvel élément qui pourrait en partie expliquer la sous-représentation des queers non blanc·hes dans les espaces queer. À ce qui est vécu comme une injonction à souscrire à une « façon d’être queer » en rupture avec leurs modèles intimes raciaux, la plupart des enquêté·es préfèrent le désinvestissement des scènes queer militantes. Aujourd’hui aucun·e n’est en rupture avec leur communauté non blanche (militante comme privée) tandis que, à l’inverse, plus aucun·e ne se dit encore durablement actif·ves sur la scène queer blanche. Reste ensuite la possibilité d’investir une « troisième voie », à la fois queer et non blanche [28].
En choisissant le silence, les enquêté·es sont-iels pour autant moins « assumé·es » que le seraient un·e homologue ouvertement out ? Cette interrogation rejoint la critique que la théoricienne Saba Mahmood fait des théories féministes libérales et leurs présupposés normatifs [29]. En effet, dans ses travaux, celle-ci conteste la tendance hégémonique des féministes libérales à penser la capacité d’agir du sujet féministe en termes binaires de soumission ou subversion. Selon elle, dans ce cadre libéral « progressiste » et eurocentré, le sujet féministe est presque exclusivement pensé comme un sujet « libéré ». Ce faisant, ces féministes n’associent la capacité d’agir des dominé·es qu’aux actes de résistance qui s’opposent frontalement aux formes de pouvoir dominant. Ce qui est dissimulé par ce cadre théorique binaire, ce sont toutes les autres modalités par lesquelles les sujets en viennent à vivre les normes du pouvoir régulateur : un silence peut être aussi délibéré qu’assumé, même sans démonstration ni explicitation. Aussi, il paraît présomptueux de penser que ce qui peut être lu comme acte de soumission / résistance par un sujet queer progressiste libéral et blanc le sera aussi par un sujet queer se référant, en partie, à des normes tranchant avec ce cadre libéral-séculier. En se focalisant sur la « déclaration de soi », ouverte et répétée, ce rapport binaire à l’(in)visibilité est vécu comme constitutif d’une éthique non hétérosexuelle blanche, libérale, séculière, incluant difficilement des formes alternatives de négociation d’identités. On postule une communauté non-hétérosexuelle homogène dans son rapport à sa visibilité sexuelle et on occulte les éthiques queer que des considérations entre autres raciales ou religieuses amèneraient à influencer. Selon l’interprétation de Mahmood, la résilience et la patience que les enquêté·es décrivent seraient considérées par ce même cadre théorique féministe libéral comme antinomiques à la capacité d’agir [30]. Leur malaise avec les sphères queer blanches fait écho à cette critique.
Au contraire, peut-on envisager que les enquêté·es aient sciemment choisi ces modalités d’existence ? Endurance, résilience et patience, ensemble, ces trois termes peuvent être traduits en arabe par le nom ‘as-sabr’, concept récurrent dans le Coran et la Sunna [31] et très discuté en théologie musulmane. Entre modération et persévérance, ce terme désigne une des plus importantes vertus prônées en Islam et renvoie, entre autres, au verset 8:46 du Coran — « et soyez endurant·es (aşbirū), car Allah est avec les endurant·es (aş-sābirīna) ». As-sabr préconise la persévérance face aux difficultés du quotidien et est une vertu encore largement enseignée au sein des communautés musulmanes en France. Mis en lien avec le vécu des enquêté·es arabisant·es et ayant été socialisé·es au contact de l’Islam (soit quatre enquêté·es sur six, Leïla, Ana, Soraya et Inès) et avec le rapport qu’iels entretiennent à leur propre visibilité sexuelle, ce terme apparaît comme un élément particulièrement éclairant pour comprendre leur récit. De fait, beaucoup voient dans les qualités que préconise cette vertu, et dans le régime tacite qu’elle peut sous-tendre, des valeurs tout autant dignes d’être défendues que celle d’une visibilité sexuelle fièrement affichée.
Réduire le choix pour certain·es de ne pas dire leur sexualité à une preuve au mieux de leur soumission à la norme hétérosexiste, au pire de l’intériorisation de l’homophobie « inhérente » à leurs modèles culturels, ce serait appauvrir l’expérience qu’iels font de leur visibilité sexuelle. Si les enquêté·es ne sont certes pas hétérosexuel·les, iels ne sont pas non plus blanc·hes. Socialisé·es avec cette réalité, leur rapport à leur propre visibilité en est profondément marqué et leurs vécus fragilisent le cadre de pensée militant partagé entre identité dite et tue, montrée et cachée, assumée et refoulée. En cela, iels questionnent ce que l’injonction à souscrire à cette hypervisibilité a de racialement exclusif.
Être queer non blanc·hes par la théorie, une conscience de soi politisée ?
En première et deuxième partie, j’ai relevé deux spécificités non blanches dans les vécus queer des enquêté·es : le sentiment d’un conflit d’allégeance entre enjeux de race et de sexualité, et l’expression d’un régime de visibilité alternatif, vécu comme en rupture avec les « codes blancs ». Cependant, au-delà des récits de vie auxquels iels se sont prêté·es, le registre même de leur récit me semble constituer une troisième spécificité de ce groupe : leur manière particulièrement consciente et politisée de mettre en discours théorique leur vécu en tant que queers non blanc·hes.
En effet, tout·es les enquêté·es démontrent une maîtrise de concepts relatifs aux théories queer et décoloniales, que ce soit par la traduction des difficultés quotidiennes en conflit entre « passing » et « coming out » dans le cas d’Inès ; par une claire identification en tant que « queer », « fem », « non binaire » chez Ana ; par la revendication d’une lutte « décoloniale et intersectionnelle » précisément située pour Charlotte. C’est par exemple en décrivant par quelles expérimentations théoriques de ses identités elle est passée que Soraya évoque ce que la « découverte » du terme « queer » a eu de libérateur dans son rapport à ses identités :
Pour moi, découvrir et m’approprier le mot « queer » et tout ce qu’il peut vouloir dire, ça a été une libération. J’ai plus un souci de légitimité à chercher. Quand j’étais plus jeune, j’en souffrais qu’on me dise « soit t’es lesbienne, soit tu l’es pas », et seulement alors ça leur paraissait concevable que je sois arabe, sans qu’il y ait vraiment d’alternatives possibles. Et dans ma tête c’était tellement plus nuancé. Mais maintenant, en moi c’est tellement fluide que même les gens ça les fatigue de savoir dans quelle optique je suis.
Ainsi, en partie par l’investissement d’un concept fluide et complexe, Soraya a su dépasser le conflit d’allégeance entre son identité arabe et son identité de sexualité. Finalement, par des détours théoriques, il semblerait qu’elle « récupère » dans sa subjectivation une partie de l’autonomie qui lui est retirée dans un monde social la dominant au moins doublement.
De simples objets de la (re)connaissance sociale et politique des autres dans la plupart de leurs sphères quotidiennes, les enquêté·es redeviennent, par leur discours, maître·sses de leur subjectivation. Dans un deuxième temps, c’est aussi grâce à leur maîtrise théorique de leurs identités et des enjeux qu’elles recouvrent qu’iels se positionnent politiquement en tant que queer non blanc·hes. Par exemple, pour Leïla, c’est sa maîtrise du concept d’homonationalisme qui lui permet de savoir quel comportement adopter avec quel groupe social :
L’homophobie de certains racisé·es je pense que c’est pas que à cause d’eux. C’est parce qu’on leur a fait croire que c’était un truc de Blanc d’être homo. Et puisqu’ils sont la cible des Blancs, c’est encore plus facile de taper sur les homos. Pour moi, l’homophobie des racisé·es, c’est pas un mythe, ça existe, mais c’est quelque chose qui se désenclenchera tout seul une fois qu’on aura montré aux Blancs qu’on peut être racisé·es et homo. Et c’est pas une raison pour eux de mieux nous accepter : c’est pas parce qu’on est homo qu’il faut nous accepter en tant que racisé·e « rejeté·e de sa communauté ». Je dis pas qu’il faut pas lutter contre l’homophobie dans nos communautés. C’est un fait et notre existence même fait partie de ce combat. […] Moi toute seule je suis devenue de moins en moins homophobe, et j’ai espoir que ça se passe pareil chez les racisé·es par rapport à leur homophobie alors que les Blancs et l’homonationalisme c’est un autre truc. Pour moi c’est pas deux choses identiques, et c’est pour ça qu’on a trouvé deux mots différents pour les qualifier. Pour moi, il faut lutter contre l’homonationalisme mais aider les racisé·es à désamorcer leur homophobie.
En décryptant la figure de l’« homo » accepté·e seulement parce que « rejeté·e de sa communauté », Leïla articule une réflexion partagée par tou·tes les enquêté·es : certaines figures queer — blanches — sont plus valorisées que d’autres — non blanches. Si Leïla est la seule à l’avoir mentionné, tou·tes en ont mobilisé le principe. Tou·tes ont conscience que si leur régime alternatif de visibilité gêne, c’est aussi parce qu’en tant que queers non blanc·hes, iels font les frais des rhétoriques des nationalismes sexuels [32] et de l’instrumentalisation de l’homophobie de certain.e.s membres de leur communauté de race. En s’inscrivant par la théorie dans un cadre de compréhension politique structurelle, les enquêté·es non seulement s’accommodent de leurs différentes identités mais savent comment composer avec leurs environnements multiples.
Conclusion
En traversant les différents espaces hétéronormatifs et homonormatifs avec leurs tensions pensées et vécues comme contradictoires, les vécus queer non blanc·hes des enquêté·es remettent en cause le postulat d’un régime de visibilité queer universel. Pour Soraya, Ana, Leïla, Émilie et Charlotte comme pour Inès, le racisme qui accompagne leur quotidien a des effets concrets sur leur identification sexuelle. Dans une France postcoloniale peu encline à traiter les conséquences contemporaines de son histoire impérialiste, les enquêté·es ne veulent pas, ni ne peuvent se permettre de rupture avec leur communauté de race, refuge trop précieux contre le racisme qu’iels subissent. Ainsi, au constat qu’il est inenvisageable pour leur entourage d’être à la fois non blanc·he et non hétérosexuel·le, aucun·e ne répond aujourd’hui par l’alignement exclusif sur l’une ou l’autre des identités. Plus encore, par la théorisation d’une identité politique, les enquêté·es non seulement cherchent à concilier leurs identités vécues comme inconciliables, mais traduisent ce conflit d’allégeance en un clair positionnement politique. Finalement, en pratique comme dans leur discours, la réalité que les enquêté·es décrivent tranche avec une logique homonationaliste qui les voudrait inéluctablement caché·es et persécuté·es par leur communauté de race [33].
Malgré les différences de classe qui séparent Ana, Charlotte, Émilie, Inès, Leïla et Soraya des 21 lesbiennes maghrébines qui ont participé aux recherches de Salima Amari, majoritairement issues de milieux ouvriers, nos recherches rapportent des conclusions souvent comparables, notamment sur la notion de « sujets tacites ». Dans un contexte systémiquement raciste et pour autant colorblind tel que celui de la France, l’expérience quotidienne commune — niée — de racisme quotidien et le besoin de solidarité de race pour y faire face participent à la transversalité de la race, et ce en partie malgré les rapports de classe. Aussi, si désertion des espaces queer il y a à l’échelle de ce groupe d’enquêté·es, il me semble qu’elle peut être en partie expliquée par l’inadéquation de leurs codes de visibilité queer. Ces codes renvoient à un régime de visibilité, explicite et ostentatoire, en rupture avec le rapport que nourrissent les enquêté·es à leur visibilité sexuelle. Puisque ce régime de visibilité est, en termes raciaux du moins, excluant, il peut être qualifié de blanc.
Si le queer a pu initialement évoquer une critique radicale des normes assimilationnistes, il peut prendre lui aussi un tournant libéral ; non pas comme le font les groupes LGBT en se concentrant sur l’« égalité des droits » que le queer critique dans son projet originel, mais en refusant de questionner la persistance de critères libéraux dans son éthique sexuelle. Adoptées par une large part de la frange blanche des communautés queer, les normes du régime d’hypervisibilité dominant peuvent en venir à contraindre les personnes non blanches à une « façon d’être queer » qui, pour assurer leur « libération », passe non pas par une remise en question de normes blanches et libérales, mais au contraire par leur adoption et leur reproduction. En déconstruisant l’importance cruciale qu’a l’injonction à l’hypervisibilité ; en rappelant l’eurocentrisme des codes disponibles pour se penser queer et leur inadéquation à des vécus échappant à ces codes blancs ; en identifiant ce que la sous-représentation des queers non blanc·hes révèle de ce que l’injonction au coming out a de faussement universel…, les spécificités de vécus de queers non blanc·hes pointent les limites du postulat d’un sujet queer universel, indépendant de toute affiliation raciale ou religieuse, et interrogent les mécanismes postcoloniaux qu’il cache.
Références
AMAOUCHE, Malika. 2005. « Les Gouines of color sont-elles des indigènes comme les autres ? » Vacarme 72 : 159-169.
AMARI, Salima. 2012. « Des Lesbiennes en devenir. Coming-out, loyauté filiale et hétéronormativité chez des descendantes d’immigrant·e·s maghrébin·e·s » Les Cahiers du Genre 53 : 55-75.
AMARI, Salima. 2013. « Sujets tacites. Le cas de lesbiennes d’origine maghrébine » Tumultes 41 : 205-221.
AMARI, Salima. 2015. Des Équilibres instables. Construction de soi et relations familiales chez les lesbiennes maghrébines migrantes et d’ascendance maghrébine en France. Thèse de doctorat en sociologie. Saint-Denis : université Paris 8.
AMARI, Salima. 2015. « Certaines lesbiennes demeurent des femmes » Nouvelles Questions Féministes 34 : 70-83.
CERVULLE, Maxime. 2010. Homo Exoticus. Race, classe et critique queer. Paris : Armand Colin
DECENA, Carlos. 2011. Tacit Subjects : Belonging and Same-Sex Desire among Dominican Immigrant Men. Durham : Duke University Press.
DUGGAN, Lisa. 2001. « The New Homonormativity : The Sexual Politics of Neoliberalism », in Materializing Democracy : towards a revitalized cultural politics, CASTRONOVO, Russ & NELSON, Dana D. (éd.). Durham : Duke University Press, 175-194.
FOGEL, Frédérique. 2007. « Mémoires mortes ou vives. Transmission de la parenté chez les migrants », Ethnologie française 37 : 509-516.
FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Paris : Éditions Gallimard.
GUÉNIF-SOUILAMAS, Nacira. 2005. « La Fin de l’intégration, la preuve par les femmes » Mouvements 39-40 : 150-157.
GROUPE DU 6 NOVEMBRE. 2001. Warriors/ Guerrières. Paris : Nomades’Langues Éditions.
JAUNAIT, Alexandre, LE RENARD, Amélie & MARTEU, Élisabeth. 2013. « Nationalismes sexuels ? Reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes » Raisons politiques 49 : 5-23.
KOHNEN, Melanie. 2016. Queer Representation, Visibility, and Race in American Film and Television. New York : Routledge.
KANUHA, Valli Kalei. 1999. « The Social Process of “Passing” to Manage Stigma : Acts of Internalized Oppression or Acts of Resistance ? » The Journal of Sociology & Social Welfare 26 : 27-46.
MAHMOOD, Saba. 2009. Politique de la piété, le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique. Paris : La Découverte.
PUAR, Jasbir K. 2012 [2007]. Homonationalisme. Politiques queers après le 11 septembre (M. Cervulle & J. Minx, trad.). Paris : Éditions Amsterdam.
PUAR, Jasbir K. 2013. « Homonationalisme et biopolitique » (M. Cervulle, trad.) Cahiers du Genre 54 : 151-185.
RWIGEMA, Marie-Jolie. 2014. « The Normative Idea of Queer is a White Person » Journal of Lesbian Studies 18 : 174–191.
SCHWARTZ, Olivier. 2012. Le monde privé des ouvriers. Paris : PUF.
SEDGWICK, Eve Kosofsky. 2008 [1990]. Épistémologie du placard (M. Cervulle, trad.). Paris : Éditions Amsterdam.
Notes
[1] AMAOUCHE, Malika. 2005. « Les Gouines of color sont-elles des indigènes comme les autres ? » Vacarme 72 : 159-169.
[2] Au début du xxe siècle, le terme n’a pas de connotation sexuelle mais englobe un champ de significations associées à la déviance. Son emploi par des groupes structurellement renvoyés à une marginalisation sexuelle et sexuée a une double visée : la réappropriation théorique d’une interpellation humiliante ainsi que la continuité militante d’une appellation lancée par l’organisation Queer Nation issue du groupe ACT UP de New York en 1990.
[3] À l’image de groupes se revendiquant queer comme la Queer Week, Existrans ou des collectifs universitaires queer, et autour desquels gravitent la plupart des membres de l’entourage queer des enquêté·es. Tous ont été critiqués pour leur blanchité notamment par des groupes queer racisés émergents tels que les groupes Qitoko ou Queer & Trans Révolutionnaire.
[4] Sur la question, voir l’ensemble des productions du Groupe du 6 novembre dont 2001, Warriors/ Guerrières, Paris : Nomades’Langues Éditions.
[5] PUAR, Jasbir K. 2007. Homonationalisme. Politiques queers après le 11 septembre (M. Cervulle & J. Minx, trad.). Paris : Éditions Amsterdam.
[6] DUGGAN, Lisa. 2001. « The New Homonormativity : The Sexual Politics of Neoliberalism », in Materializing Democracy : towards a revitalized cultural politics, CASTRONOVO, Russ & NELSON, Dana D. (éd.). Durham : Duke University Press, 179.
[7] DECENA, Carlos. 2011. Tacit Subjects : Belonging and Same-Sex Desire among Dominican Immigrant Men. Durham : Duke University Press.
[8] AMARI, Salima. 2015. Des Équilibres instables. Construction de soi et relations familiales chez les lesbiennes maghrébines migrantes et d’ascendance maghrébine en France. Thèse de doctorat en sociologie. Saint-Denis : Université Paris 8.
[9] AMARI, Salima. 2013. « Sujets tacites. Le cas de lesbiennes d’origine maghrébine » Tumultes 41 : 205-221.
[10] AMARI Salima. 2012. « Des Lesbiennes en devenir. Coming-out, loyauté filiale et hétéronormativité chez des descendantes d’immigrant·e·s maghrébin·e·s » Les Cahiers du Genre 53 : 55-75.
[11] Trois des enquêté·es s’identifient comme non binaires. Pour respecter leur identité de genre, j’ai choisi un système de grammaire ne prenant ni le masculin ni la binarité comme normes d’écriture. Ainsi, « elle » ou « il » devient « iel », « celles » ou « ceux », « ceulle ».
[12] Par souci d’anonymat, tous les prénoms ont été modifiés.
[13] AMARI, Salima. Des équilibres instables…, op. cit.
[14] SCHWARTZ, Olivier. 2012. Le monde privé des ouvriers. Paris : PUF, 10.
[15] SEDGWICK, Eve Kosofsky. 2008 [1990]. Épistémologie du placard (M. Cervulle, trad.). Paris : Éditions Amsterdam.
[16] GUÉNIF-SOUILAMAS, Nacira. 2005. « La Fin de l’intégration, la preuve par les femmes » Mouvements 39-40 : 150-157. Voir ses travaux traitant en profondeur l’inscription des enfants issu·es de l’immigration postcoloniale dans l’organisation familiale, notamment des « filles issues de l’immigration nord-africaine » qu’elle appelle les « beurettes ».
[17] SEDGWICK, Eve Kosofsky. Épistémologie du placard, op. cit.
[18] Par « régime de visibilité », j’entends la notion telle que développée par Michel Foucault dans Surveiller et Punir. Ce concept est largement discuté dans la littérature post-structuraliste et je retiendrai l’idée d’une formation historiquement et géographiquement située d’un ensemble de mécanismes, connaissances, discours scientifiques et politiques, qui concourent à construire une distinction entre ce qui relève du visible ou de l’invisible, notamment dans le domaine des sexualités. « L’examen intervertit l’économie de la visibilité dans l’exercice du pouvoir ». FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Paris : Éditions Gallimard, 219-220.
[19] J’emprunte à Saba Mahmood sa réflexion sur le « libéralisme séculier » de ce qu’elle appelle les « féministes post-structuralistes ». En ce qui concerne la notion de libéralisme, gardons l’idée d’une doctrine philosophique du xixe qui se réclame de la liberté économique, politique et religieuse faisant de l’individu et de ses droits (notamment celui de sa liberté) un principe et un enjeu d’organisation sociale. Pour ce qui est du sécularisme, il renvoie ici à la tradition (a)religieuse issue des Lumières et traduit une tendance au transfert des principales valeurs (éthiques, morales, sociales) régissant l’organisation sociale du domaine du sacré à celui du profane. Ces deux mouvements conjoints se posent en partie en rupture avec les cadres et référents culturels et religieux non eurocentrés (notamment musulmans) dans lesquels s’inscrivent en partie les enquêté·es. MAHMOOD, Saba. 2009. Politique de la piété, le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique. Paris : Éditions La Découverte.
[20] En 1997, Kanuha mène une enquête qualitative auprès de 29 personnes s’identifiant comme lesbiennes et gay of color aux États-Unis. Elle y défend la pratique du passing comme une stratégie de gestion de stigmate en résistance à une oppression. KANUHA, Valli Kalei. 1999. « The Social Process of “Passing” to Manage Stigma : Acts of Internalized Oppression or Acts of Resistance ? » The Journal of Sociology & Social Welfare 26 : 27-46.
[21] RWIGEMA, Marie-Jolie. 2014. « The Normative Idea of Queer is a White Person » Journal of Lesbian Studies 18 : 174–191.
[22] KOHNEN, Melanie. 2016. Queer Representation, Visibility, and Race in American Film and Television. New York : Routledge.
[23] FOGEL, Frédérique. 2007. « Mémoires mortes ou vives. Transmission de la parenté chez les migrants » Ethnologie française 37 : 509-516.
[24] Ibid.
[25] CERVULLE, Maxime. 2010. Homo Exoticus. Race, classe et critique queer. Paris : Armand Colin.
[26] Voir le concept d’« hétérosexualité de façade » dans AMARI, Salima. 2015. « Certaines lesbiennes demeurent des femmes » Nouvelles Questions Féministes 34 : 70-83.
[27] Ibid.
[28] Depuis la fin de mon enquête, Charlotte et Lily s’investissent nouvellement auprès de groupes queer racisés.
[29] MAHMOOD, Saba. Politique de la piété…, op. cit.
[30] Ibid. p. 31.
[31] Constitue l’ensemble des dires et faits du prophète Muhammed.
[32] JAUNAIT, Alexandre, LE RENARD, Amélie & MARTEU, Élisabeth. 2013. « Nationalismes sexuels ? Reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes » Raisons politiques 49 : 5-23.
[33] PUAR, Jasbir K. 2013. « Homonationalisme et biopolitique » (M. Cervulle, trad.) Cahiers du Genre 54 : 151-185.
Ce texte n’engage que la responsabilité de son autrice. Les textes du collectif sont signés « Par le Collectif Irrécupérables ».